Extrait de « Le Crépuscule des Dieux, Tome II : Le front de l’Est » — Krzysiek Świętomierz — Éditions Cletis.
En 1945, alors que la Wehrmacht tente de protéger les derniers puits de pétrole en Hongrie, se joue l’une des dernières grandes batailles de la guerre. C’est l’offensive Vistule-Oder ou 2 millions de soldats soviétiques vont affronter 650 000 Allemands dans une guerre de mouvement apocalyptique à travers toute la Pologne.
Après les succès remportés par l’offensive soviétique Bagration durant l’été 1944, la progression de l’Armée rouge est stoppée par la bataille de Radzymin-Wołomin et l’opération Herbststurm. Le reste de l’année a donc été employé par les Soviétiques à pallier leurs difficultés de ravitaillement et à attendre l’écrasement par les Sicherungs[1] du soulèvement de Varsovie. De plus, durant l’automne 1944 les troupes allemandes offrent une résistance inattendue à l’Armée rouge, refoulant une offensive en Prusse-Orientale et reprenant même des villes prussiennes. Ces villes ont été le lieu de déprédations soviétiques : 26 civils ont été massacrés avec une cruauté sans nom. Revigorés par la publicité qui en est faite par les services de propagande, les soldats de la Wehrmacht engagée sur le front de l’Est opposent une résistance de plus en plus affirmée à la pénétration soviétique sur le territoire Allemand.
Durant cette opération, le déséquilibre entre les forces allemandes et les troupes soviétiques est important. Les Soviétiques alignent quatre fois plus de soldats que les Allemands, qui ont 650 000 soldats sur ce front, 12 fois plus de chars et de canons, soit 7 000, et 10 fois plus d’avions (environ 5 000).
Les troupes allemandes sur ce secteur du front sont composées d’unités comportant des unités SS dissoutes, des membres du Volkssturm, des hommes de la Krigsmarine et le Lufftawaffe reversé dans l’Armée, amalgamée avec les rescapés des batailles précédentes. Les unités des Sicherungs sont distraites de leur tâche militaire par l’aide qu’elles apportent aux réfugiés des régions de l’Est. De plus, de nombreuses unités en cours de formation ou de reconstitution doivent tenir ce front, face à des armées soviétiques homogènes et aguerries.
Le Maréchal Erich von Manstien a déjà averti le Maréchal Guderian qu’il ne pourrait pas arrêter les troupes soviétiques lorsque celle-ci passerait à l’attaque. Aussi son plan consiste à les ralentir et les affaiblir le plus possible dans une guerre de mouvement pendant que Guderian met l’Oder en défense avec plus d’un million d’hommes.
Ordre de bataille soviétique
1er Front de Biélorussie (Maréchal Gueorgui Joukov) :
- 47ème Armée
- 1ère Armée polonaise
- 3ème Armée de Choc
- 61ème Armée
- 1ère Armée blindée de La Garde
- 2ème Armée blindée de La Garde
- 5ème Armée de Choc
- 8ème Armée de La Garde
- 69ème Armée
- 33ème Armée
1er front d’Ukraine (Maréchal Ivan Koniev) :
- 21ème Armée
- 6ème Armée
- 3ème Armée de La Garde
- 13ème Armée
- 4ème Armée blindée
- 3ème Armée blindée de La Garde
- 52ème Armée
- 5ème Armée de La Garde
- 59ème Armée
- 60ème Armée
Ordre de bataille allemand
Les forces allemandes sont sous le commandement du Groupe d’armées Vistule-Oder du Maréchal Erich Von Manstein).
3ème Panzerarmee :
- 40ème Panzerkorps (551ème Division de Grenadier, 7ème Panzerdivision, 20ème Panzerdivision).
- 9ème Armeekorps (252ème, 56ème, 69ème et 95ème Divisions d’Infanterie, 548ème Division de Grenadier).
- 6ème Armeekorps (197ème, 256ème et 299ème Divisions d’Infanterie).
- 53ème Armeekorps (206ème, 246ème et 707ème Division d’Infanterie).
2ème Armée :
- 8ème Armeekorps (5ème Jäger Division, 221ème, 251ème et 7ème Divisions d’Infanterie).
4ème Armée :
- 12ème Armeekorps (57ème et 267ème Divisions d’infanterie, 18ème Panzergrenadier Division).
- 39ème Panzerkorps (12ème, 31ème, 110ème et 337ème Divisions d’Infanterie et 19ème Panzerdivision).
- 27ème Korps (78ème Division d’assaut, 260ème Division d’Infanterie, 25ème et 60ème Panzergrenadier Division).
9ème Armée :
- 55ème Armeekorps (102ème, 292ème et 14ème Divisions d’Infanterie).
- 31ème Armeekorps (35ème, 36ème et 129ème Divisions d’Infanterie).
- 35ème Armeekorps (6ème, 45ème, 134ème, 296ème et 383ème Divisions d’Infanterie).
17ème Armée :
- 59ème Armeekorps (68ème, 75ème, 243ème et 359ème Divisions d’infanterie, 544ème Division de Volks-Grenadier).
- 11ème Armeekorps (168ème, 254ème, 69ème, 371ème et 344ème Divisions d’infanterie, 1ère Division de chasseur à ski).
Situation tactique
La concentration des unités soviétiques en vue de cette offensive est impossible à masquer aux observateurs allemands. Heinz Guderian, Reinhard Gehlen[2] et Erich von Manstein pensent être parfaitement informés des intentions soviétiques. Les responsables soviétiques se fixent donc comme objectif, lors de la phase de préparation opérationnelle, de masquer l’ampleur des concentrations et les véritables objectifs de l’offensive à venir. Les mouvements de troupes sont soigneusement masqués, les unités s’installent selon le dispositif exact des unités qu’elles relèvent, destinées à être déployées sur d’autres secteurs du front.
De plus, une vraie fausse activité est ainsi générée le long de certains axes, de façon à leurrer les Allemands sur la véritable nature des objectifs soviétiques. Des agents soviétiques se font passer pour des déserteurs et confirment le sérieux de ces activités, de faux trafics radios sont organisés, des faux états-majors, de fausses unités, dotées de chars en bois, de fausses positions d’artillerie sont établis de façon visible le long de certains axes. Les reconnaissances sont doublées. Ces mesures aboutissent à persuader Reinhard Gehlen que la Silésie constitue le principal objectif des préparatifs soviétiques.
Par ces mesures, les Soviétiques parviennent partiellement à masquer l’ampleur de leur concentration. En effet, jusqu’au début du mois de janvier Gehlen est incapable de prévoir autant la direction et la nature de la manœuvre soviétique que les moyens déployés par l’Armée rouge pour cette opération. La localisation précise d’une partie des fortes unités soviétiques est totalement ignorée des services de renseignement militaires allemands. Seul Erich von Manstein, se fiant à son instinct, prend la mesure du choc qui se prépare.
Préparatifs
Lors de la phase de préparation, un seul choix s’offre aux stratèges soviétiques : le franchissement de la Vistule de part et d’autre de Varsovie suivi d’attaques de rupture à partir des têtes de pont conquises. Les deux objectifs fixés sont Czestochowa et Breslau, situés très en arrière du front. Une fois la rupture obtenue, les unités blindées doivent foncer à marche forcée en direction de Lódz, puis au-delà de Posen, où doit s’opérer la jonction entre les deux fronts engagés dans l’opération.
Le plan est testé lors de Kriegsspiele[3] durant lesquels l’opération est nommée Varsovie-Posen. Le franchissement de la Vistule possède l’inconvénient de laisser aux Allemands le temps d’appeler des renforts pour contenir les poussées soviétiques, mais réunit les conditions d’une attaque-surprise.
Les Kriegsspiele organisés par les commandants de front sont d’autant plus efficaces qu’ils s’appuient sur une parfaite connaissance du terrain à conquérir. Les unités blindées ne doivent pas s’arrêter longtemps afin de remplir leur objectif opérationnel, la constitution de tête de pont sur l’Oder à moins de 100 km de Berlin. Ainsi, les 3 500 missions de reconnaissance aériennes des mois précédant le déclenchement des opérations, la multiplication d’agents infiltrés dans les profondeurs du dispositif allemand, jusque dans la banlieue de Berlin, la capture de prisonniers donne aux commandants soviétiques une parfaite connaissance de ce dispositif, jusqu’à 40 km en arrière de la ligne de front et de ses points faibles. À cette observation systématique, rendue possible par l’importance des effectifs affectés à cette tâche, s’ajoutent les écoutes et la coordination des informations d’un bout à l’autre du front. Joukov est ainsi avisé du transfert de fortes unités blindées vers la Hongrie.
Tout est facilité pour permettre à la poussée soviétique d’avancer le plus possible : constitution d’ateliers mobiles de réparation pour les moyens blindés, dotations de moyens techniques pour les besoins de chaque corps blindé. Cette utilisation plus souple des ateliers de réparation se révèle payante, puisque 9 000 chars d’assaut soviétiques sont réparés en janvier 1945 en Pologne.
Une forte préparation d’artillerie
L’offensive débute le 12 janvier 1945 à 5 heures du matin, par un tir de barrage de 7 000 canons soviétiques. Tir très efficace, mais qui ne constitue nullement une surprise pour les Allemands.
La gigantesque préparation d’artillerie s’opère en deux temps pour la partie de l’offensive confiée à Koniev. À 5 heures, une première vague de tir de 81 minutes en feu roulant aboutit à envoyer sur les lignes allemandes et leur arrière immédiat près de 1 050 tonnes d’explosifs, faisant exploser les blockhaus de la défense, les dépôts de munitions les plus près du front, détruisant les tranchées et les routes. À 9 h 30, la seconde vague de tirs, beaucoup plus longue (5 h 35) ravage le dispositif allemand, le rendant aveugle et muet. Durant ces préparations, 15 ponts flottants sont installés, sans que les Allemands le remarquent, afin de permettre l’introduction des unités de choc.
Franchissements et percées
À l’issue de cette première préparation massive qui écrase les défenses allemandes, les premières unités de choc soviétique traversent le fleuve en 15 points et la surprise est totale chez les défenseurs assommés par l’artillerie. Des reconnaissances renforcées sont lancées sur les positions allemandes par des groupes mixtes infanterie et de blindés. Les premières lignes allemandes sont ainsi conquises dès le premier jour, notamment en raison de la simultanéité des préparations d’artillerie et de manœuvres de franchissement de troupes de choc.
Dès le deuxième jour, plusieurs vagues d’assaut soviétiques sortent des têtes de pont établies sur la Vistule et prennent d’assaut les tranchées allemandes. Rapidement, ces avancées soviétiques rompent le front allemand en Pologne, par une percée d’une profondeur de 12 km sur une largeur de 30 km, tandis que plus de 20 kilomètres sont parcourus par des chars soviétiques que rien ne parvient à stopper. Le Maréchal von Manstein ordonne à des unités de reculer, mais il lui apparaît clairement qu’elles auront du mal à se coordonner. À la suite de la première percée, l’artillerie allemande est balayée par une phase de 6 heures de bombardement de l’artillerie soviétique. Dans le même temps, des couloirs sont épargnés afin de permettre l’infiltration massive d’unités soviétiques pour tenter d’encercler les unités allemandes qui entament leur repli.
Dès le 18 janvier 1945, certaines unités placées en réserve opérationnelle sont neutralisées par les pointes soviétiques. Après 6 jours de résistance, l’ensemble des troupes allemandes recule, abandonnant des milliers de prisonniers, et une quantité importante de matériel.
À partir du 20 janvier, Joukov lance ses unités à partir des têtes de ponts situés au sud de Varsovie. Comme Koniev au Sud, il prévoit une préparation d’artillerie massive en deux temps. Profitant de la désorientation des soldats allemands, les unités soviétiques avancent, faisant bombarder massivement chaque poche de résistance.

Une guerre de mouvement
La percée est définitivement obtenue le 20 janvier 1945 dans le secteur de Koniev. Le commandement soviétique lance l’exploitation, empêchant la concentration des unités allemandes sur la seconde ligne de front. En effet, deux armées blindées soviétiques se lancent à l’assaut de ce qui reste de la Pologne allemande dès le 19 janvier à partir de la percée opérée par les troupes de Koniev. Les unités placées sous la responsabilité de Joukov se meuvent en priorité en direction de Lodz et Posen. Dès le 17 janvier 1945, Varsovie est prise par les Soviétiques. Le 22 janvier, la ville de Lodz est investie sans combat, la garnison allemande ayant fui durant la nuit. Dès le 19 janvier, les unités allemandes ne sont plus en mesure de stopper à la progression des unités de Joukov. Les Allemands se déplacent le plus vite possible la nuit et combattent toute la journée. Von Manstein décide de laisser une grande marge de manœuvre aux commandements locaux avec pour seules consignes « ralentissez-les le plus possible, infligez-leur des pertes, évitez la destruction de vos unités ».

La Warthe est atteinte le 28 janvier 1945 et est franchie le surlendemain, en dépit de l’envoi de renforts allemands, composés en partie de bataillons du Volkssturm, rapidement débordés et repoussés. Posen, abandonner est encercler par les Soviétiques à partir du 22 février 1945.
Pendant 20 jours, les troupes soviétiques progressent de 20 kilomètres par jour. Elles s’arrêtent sur le cours moyen de l’Oder, stoppé par le brusque dégel de la fin janvier, par des difficultés de ravitaillement et par le souhait du commandement soviétique de marquer une pause, à la fois pour contrôler des flancs nord et sud, jugé vulnérable, et pour reprendre le contrôle sur des troupes que l’entrée en Allemagne rend indisciplinées. Elles contrôlent des têtes de pont sur la rive gauche du fleuve, en Silésie en aval de Breslau. Le 13 février, un coup de main d’un régiment de fusiliers soviétiques aboutit à la constitution de la première tête de pont à l’ouest de l’Oder, prenant par surprise la petite ville de Kienitz à l’aube, devant des Allemands éberlués. Cette modeste tête de pont est rapidement renforcée par des moyens en artillerie et doit rapidement affronter de fortes contre-attaques allemandes, montées avec tous les moyens disponibles. Le « Gruppe Hinz » de la 4. Fallschirmjäger-Division s’illustre avec brio durant les efforts visant à contenir les têtes de pont soviétique. Sont seul et unique Panzerjäger Tiger (P)[4] appuyé par un char Tigre E détruit à lui 38 véhicules soviétiques.
Autour de Breslau[5], les opérations de franchissement se font avec plus ou moins de bonheur. Au terme de ces opérations, trois têtes de pont à l’existence précaire sont établies à l’ouest de l’Oder. Les Allemands assez bien préparer parviennent à contenir les têtes de ponds et gêner leu renforcement. La whermacht déverse sur le front de l’Oder tout le matériel qui lui reste, ainsi 1 600 canons antichars PaK 43 de 88 mm sont ainsi déployés sur le front de l’Oder tout comme le sont plus de 400 chars Tiger Ausf. B, les célèbre « Königstiger ». Les unités blindées sont renforcées également de façon significative au cours du mois de février avec du matériel neuf tout juste mis en service dans les usines de Berlin, tandis que de vastes unités sont cantonnées à proximité des têtes de pont soviétiques.
Opération Sonnenwende
Durant l’hiver et face à l’imminente attaque des Soviétiques, la Wehrmacht commence à préparer les défenses de l’Oder. L’essentiel des travaux est confié aux Volkstrums directement supervisés par le Maréchal Heinz Guderian commandant du front de l’Est. Des unités sont aussi placées en réserve derrière le fleuve en vue de l’arrivée des Soviétiques.
Lorsque le 13 février 1945, les Soviétiques franchissent l’Oder à Breslau et Kienitz, Guderian réagit rapidement. Il se rend directement sur le front pour galvaniser les troupes et lance l’opération Sonnenwende (Solstice).
Le 15 février 1945, l’artillerie allemande bombarde les arrières des unités qui ont franchi l’Oder pendant que le 15ème Corps de cavalerie cosaque et la 26ème Panzerdivision se ruent sur les têtes de pont à Breslau alors que l’Armée Vlassov[6] en fait autant à Kienitz. Les unités soviétiques sont prises par surprise, car totalement désorganisées. Les hommes de l’Armée rouge se livrent aux pillages et aux viols pour se venger des souffrances infligées par les Allemands durant la guerre.
Dès le 16 février , deux des trois têtes de pont soviétiques à Breslau sont balayées. Les Allemands font 2 000 prisonniers. La troisième tête de pont est réduite le lendemain, car les Soviétiques ont reçu l’ordre de se replier. À Kienitz, 500 soldats soviétiques désertent pour rejoindre l’Armée Vlassov. À plusieurs reprises, les Allemands sont obligés d’empêcher les cosaques d’exécuter des soldats soviétiques.
Côté allemand et dans ces conditions de combat, les chars lourds « Königstiger » s’illustrent magnifiquement. On peut citer le « Panzerabteilung 101 » qui a détruit au moins 500 chars et véhicules soviétiques pour seulement 45 pertes entre le 15 janvier et le 21 février 1945. La 47ème armée soviétique de Franz Perkhorovich est saigné à blanc.
Ralentissement puis arrêt de l’offensive
Le 22 février 1945, jour de la prise de Posen, de nombreux échanges téléphoniques se déroulent entre Staline et ses officiers généraux sur la suite de l’offensive soviétique. Staline, devenu prudent en matière de conduite stratégique du conflit, ordonne l’arrêt de l’avancée soviétique une fois l’Oder atteint. Koniev, comme nous l’avons déjà évoqué, établit cependant, dans un premier temps contre l’avis de Staline, trois têtes de pont autour de Breslau. Au milieu du mois de février, le projet d’une conquête rapide de Berlin est abandonné. Plusieurs raisons à cela : la défense acharnée de la Silésie et de la Poméranie par les unités allemandes, les pertes reçues lors de la bataille de la Prusse orientale et l’usure des unités qui ont combattu dans une guerre de mouvement à travers la Pologne. De plus, à partir de la mi-février, la logistique soviétique se montre débordée, incapable d’approvisionner une armée s’étant enfoncée de 500 kilomètres à l’avant de ses positions de départ, dans un pays désorganisé, ou encore partiellement occupé. De plus, la Luftwaffe, en mitraillant les colonnes de ravitaillement soviétiques, rend encore plus problématique l’accomplissement des missions assignées aux logisticiens de l’Armée rouge.
De même, le raidissement allemand, notamment les concentrations opérées par la Luftwaffe au cours du mois de février, participe à l’arrêt de l’offensive soviétique. Frappée de plein fouet par les ponctions de l’été précédent, handicapé par le manque de carburant et écartelé entre ses trop nombreuses missions, la Luftwaffe aligne 750 appareils, chasseurs, bombardiers, avions de reconnaissance et de transport, en Pologne et en Prusse-Orientale. Équipée d’appareils modernes, la Luftwaffe est cependant rapidement tenue en échec par la chasse soviétique bien plus nombreuse, causant la perte de nombreux pilotes expérimentés. Mais la Luftwaffe, et plus spécialement les pilotes expérimentés de chasseurs-bombardiers, prélève un lourd tribut aux unités soviétiques, tant en moyens de combats, qu’en moyens logistiques. De plus, la majorité des moyens militaires allemands est alors concentrée sur le front de l’Oder.
Depuis la pénétration soviétique en Silésie, les commandants soviétiques sont peu ou pas renseignés sur la valeur réelle des unités qu’ils sont susceptibles d’affronter. Ils sont alors tributaires de renseignements partiels fournis par leurs alliés occidentaux et par les écoutes magnétiques. Les Soviétiques ont tendance à surestimer les capacités allemandes.
Ensuite, la destruction systématique des nœuds ferroviaires et des ponts aboutit non seulement à compliquer la tâche des unités responsables de la logistique, mais aussi à obliger les stratèges soviétiques à immobiliser des unités et retardent la logistique soviétique, obligeant à la mise en place d’itinéraires ferroviaires compliqués.
S’ajoute le facteur climatique : dans la nuit du 29 janvier, un redoux climatique entraîne un brusque dégel dans la région. Cela compliqué les traversée de la Vistule et de l’Oder et transforme les sols en océan de boue, compliquant la tâche de la logistique déjà surmenée, obligeant les commandants à utiliser le chemin de fer en ruine, dans des conditions précaires et moyennant des itinéraires compliqués.
Enfin, le comportement des soldats, encouragés par la propagande de guerre, contribue aussi à l’arrêt de l’offensive. En effet, à partir du mois de juillet 1944, la propagande soviétique appelle les soldats de l’Armée rouge à venger les exactions allemandes en URSS. À tous les échelons de commandement, on multiplie les visites de centres d’exactions allemandes, de plus, près de 40 % des combattants soviétiques ont perdu un membre de leur famille du fait des exactions allemandes. Ainsi, une fois la frontière allemande atteinte, les officiers soviétiques rencontrent énormément de difficultés à maintenir la discipline, certains se font même tuer par leurs subordonnés. Des soldats plus ou moins débandés pillent systématiquement les villages et villes rencontrés, à la grande fureur de leurs officiers.
Analyses et Conclusions
L’opération Vistule-Oder est quasiment certaine d’être couronnée de succès du fait de la supériorité numérique et matérielle écrasante de l’Armée rouge. Mais d’autres facteurs expliquent l’ampleur de la victoire soviétique :
- Le transfert d’unités d’élite de la Vistule vers la Hongrie. Toutefois sans ses unités, il est très probable que l’avancée de l’Armée rouge en Hongrie puis en Autriche ait été plus rapide.
- L’échec majeur du renseignement allemand. Gelhen estime que les Russes chercheront avant tout à augmenter la taille de leur tête de pont sur la Vistule par une attaque en pince, alors que celle-ci se révélera suffisante. De plus, il sous-estime largement la taille de l’armée adverse : de 40 % pour l’infanterie, de 60 % pour les chars.
- La quasi-absence de réserve opérationnelle en moyens blindés. La Wehrmacht n’a plus assez de moyens pour maintenir à la fois une réserve tactique et une réserve blindée d’un niveau stratégique opérationnel. Dès lors, toute percée soviétique laisse les arrières très vulnérables.
- Les progrès de l’Armée rouge. Les généraux ont prouvé lors de cette opération qu’ils maîtrisaient l’art de la bataille en profondeur, la coopération interarmes et la manœuvre.
En outre, les choix opérationnels soviétiques visent à la désarticulation et à la fragmentation du front adverse. Les rares unités allemandes laissées en arrière sont ainsi réduites par les troupes de la seconde ou de la troisième vague. Ce choix de progression rapide en ligne droite vise à frapper lourdement la profondeur du dispositif militaire adverse et à rendre inutilisables les dépôts militaires, les gares, les aérodromes, les routes, les centres de communication. Le génie de von Manstein et la liberté de manœuvre qu’il laisse à ces unités permettent d’éviter un désastre grâce à une guerre de mouvement plutôt qu’une défense statique. Le Groupe d’armées Vistule-Oder est aussi aidé par les violents combats qui font rage en Prusse et en Hongrie.
L’offensive Vistule-Oder est un succès majeur pour l’Armée rouge qui réussit à faire progresser plus de 2 millions d’hommes et 300 000 véhicules de la Vistule jusqu’à 80 km de Berlin, devenue dès lors un objectif à moyen terme pour le commandement soviétique. Cette bataille a des conséquences démographiques importantes, notamment avec l’évacuation en catastrophe des populations allemandes de l’est de l’Oder. Ces déplacements de population dans un contexte d’invasion du territoire allemand créent sur les routes un chaos indescriptible.
Du point de vue militaire, la Wehrmacht est en grande difficulté. Berlin n’est plus qu’à une heure de route du front, à seulement 80 km des avant-postes soviétiques. Près de 195 000 soldats sont morts, blessés ou malades. 87 000 soldats allemands ont été capturés. 1 900 chars ont été détruits ou abandonnés ainsi que 560 avions, 22 000 véhicules, 10 000 canons et 16 000 mitrailleuses. Les pertes soviétiques sont presque aussi élevées, mais les chiffres varient du simple au double selon les sources.
Dans ces circonstances, l’armée allemande incorpore de forces des prisonniers politiques allemands et des juifs allemands, ainsi que des femmes sur la base du volontariat dans de très rares cas. Contrairement au front de l’ouest, le front de l’est voit peu de désertion, les soldats allemands semblent pleinement conscients du sort que l’URSS réserve à leur pays.
Quatre millions et demi de civils allemands, habitant la Prusse, la Silésie, la Poméranie et la Posnanie directement menacées par la poussée soviétique, connaissent les affres de l’exode. Les populations livrées à elles-mêmes tentent de fuir vers l’Ouest. De plus, le maillage territorial des régions touchées s’effondre du jour au lendemain, les Allemands pratiquement une politique de la terre brûlée. Les villes et les villages sont abandonnés en pleine journée, le bétail égorgé, les lignes électriques et téléphoniques coupées, les réserves et dépôts sont incendiés. La propagande de guerre allemande ayant été très explicite sur le sort des populations civiles si elles tombaient sous le contrôle des troupes soviétiques.
Les civils allemands ne sont pas les seuls à endurer les conséquences du succès de l’offensive soviétique : les camps de prisonniers et de travail de Pologne sont livrés à eux même. Les gardiens des camps reçoivent l’ordre d’ouvrir les cellules et les portes des camps avant d’évacuer. Ce sont des milliers de prisonniers qui se retrouvent ainsi livrés à eux même dans un environnement dangereux et avec très peu de nourriture. Toutefois, dans le chaos ambiant, certains camps sont « oublier » et restent clos jusqu’à l’arrivée des Soviétiques, notamment le triple camp d’Auschwitz-Birkenau-Monowitz. Les Soviétiques y trouvent des prisonniers qui n’ont rien mangé depuis des jours. Cependant, la rapidité de l’avance russe dans les provinces orientales crée un climat favorable à la survie des détenus, dont un certain nombre s’évadent et vivent cachés, éventuellement accueilli par des civils polonais en attendant l’arrivée des soldats soviétiques. La libération des prisonniers en janvier 1945 renforce le chaos qui règne sur les routes des provinces orientales. Soldats allemands, membres des appareils administratifs, policiers, civils et prisonniers encombrent des routes enneigées, le plus souvent à portée de l’artillerie soviétique.
[1] Les Sicherungstruppen (troupes de sécurité en français et Sicherungstruppe au singulier) étaient durant la Seconde Guerre mondiale des troupes allemandes, rattachées à la Wehrmacht, chargées du maintien de l’ordre, d’assurer la sécurité et la protection des lignes de communication et de la garde d’ouvrages à l’arrière de la ligne de front et dans les territoires occupés.
[2] Officier de la Wehrmacht, chef du service des renseignements à l’Est en 1944, promu général de brigade. Hostile aux choix stratégiques d’Hitler, il est proche des conspirateurs de juillet 1944. Il a collaboré avec les États-Unis après la guerre. En outre, il fut le fondateur et le chef du BND, les services de renseignements ouest-allemands, et ce jusqu’en 1968.
[3] Kriegspiel « jeu de (la) guerre ». Exercice de simulation et ancêtre des Wargames moderne.
[4] Aussi connu sous le nom « Elefant » ou « Ferdinand ».
[5] Actuelle Wrocław en Pologne.
[6] L’Armée de libération russe. Formation de la Wehrmacht composée de volontaires russes généralement antisoviétiques.
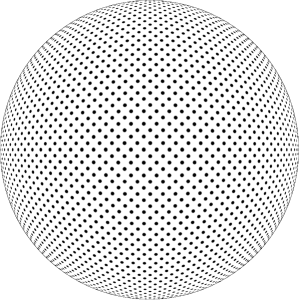
2 commentaires sur “Aller simple Varsovie-Berlin”